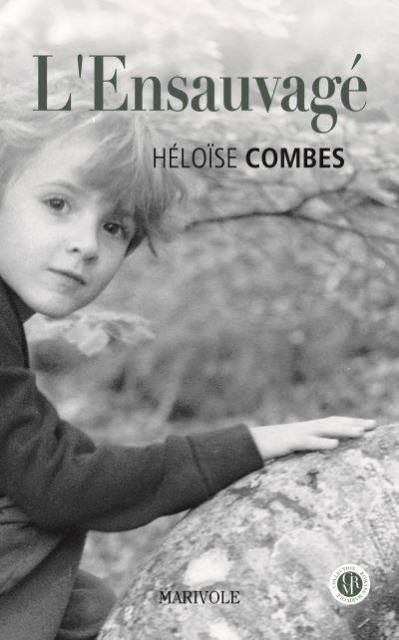Ces textes, regroupés ici, ne sont pas gais. Ils parlent de vie, pourtant.
Promis, les suivants, déjà écrits, seront plus légers !
I
rêve
J’allais par les méandres
de mon esprit endormi
partir pour un voyage
avec tous mes enfants
et même avec la « petite »
qui n’est pas encore née.
Par cette nuit de neige
je ne l’avais pas habillée
et ma mère me prodiguait
des conseils pour sa sécurité.
.
Elle était là, ma mère
debout, lucide, et jeune…
Oubliée la chaise roulante !
.
Le rêve est la maladie de mémoire
des jours qu’Alzheimer déforme.
Ainsi, aux petits pas des nuits
et des jours qui se suivent
se recrée l’équilibre d’une vie
digne de ton nom, maman,
et je dirai à ta famille
et même à l’enfant
qu’un ventre maternel cocoone,
là-bas, loin de nous seuls,
combien tu fus, pour nous tous,
une mère attentive et aimante.
II
Bernadette
Quand il faut nourrir sa mère comme une enfant,
l’entendre pleurer et appeler sa maman,
on voudrait pouvoir restaurer ses cellules,
dissoudre les chagrins, les peurs cristallisés.
Mais cela ne se peut car un « aimant » plus fort
s’est emparé d’une âme – en passant par le corps,
et toutes les déchéances ici-bas
ne sont que pénible ascension
vers une vie redoutée qu’on ignore.
Les acteurs, dans les coulisses,
tremblent derrière cette tragédie
minutieusement orchestrée
elle défie leur entendement
l’horloge compte des secondes d’éternité douloureuses.
III
Madeleine
« La vieillesse, c’est l’hiver pour les ignorants et le temps des moissons pour les sages », nous dit un proverbe.
La vieille femme s’agite dans son sommeil. De ce lit sécurisé, où il ne lui est même plus possible d’atteindre le téléphone, elle songe à joindre son fils aîné, afin de lui dire qu’elle n’est pas bien, ici ! Ses pensées transpercent le plafond, lévitent au-dessus de la ville, évitent la rocade, survolent les champs et atteignent le sommeil de sa belle-fille.
Message transmis.
Sa belle-fille réveille son mari, et lui annonce : « Ta mère souhaite te parler ! »
Par discrétion, elle a oublié de demander à sa belle-mère ce qu’elle voulait dire à son fils. Le message est donc incomplet. Vraiment, il lui faudra apprendre à poser les bonnes questions, en rêve, afin de devenir une messagère efficace !
Pour en revenir au proverbe, la moisson ne peut plus – dans la réalité de l’existence terrestre – se faire dans la vieillesse. La moisson est de tous les jours, elle accompagne la vie. Aujourd’hui on glane ce qu’on a semé hier. On s’active tant que le corps le permet. Il en faut de l’énergie pour moissonner, autant que pour labourer, à moins de recruter des saisonniers (mais là, est un autre sujet).
En plein champ, au sommet d’une meule de paille, la vieille femme serait reine, laissant à d’autres le labeur, à elle la perception de cette scène de vie agricole…. Mais ici, dans cet Ehpad, elle est tigre de paille et rugit son impuissance.
IV
Joseph
Il a pris son lit et l’a mis dans le salon.
Après soixante ans de nuits communes
il ne dormira plus jamais avec sa femme.
Les cris, les pleurs, les paroles décousues
ne lui apportent que souffrance, et rajoutent
de la confusion dans cette maison que la vie
déserte, laissant le champ libre à la déraison.
Les délires de l’une, après l’insomnie, jettent
l’autre, épuisé, si l’engourdissement le gagne,
dans les catacombes des cauchemars d’où
il ne sort que pour sombrer dans la folie
d’un jour qui a tout d’une jungle…
V
sursaut
Elle avait donné, et son corps vieillissant tentait de reprendre, à rebours du temps,
toutes les bénédictions accordées par le simple fait qu’elle leur ait donné la vie.
N’était-elle pas source ?
L’eau lui était redevable des poissons qu’elle se devait de ferrer avant de partir.
VI
espérance
On peut saisir, par temps d’amertume, le reflet d’un ange dans une flaque de pétrole…
Malgré le noir venu mazouter les œuvres blanches que le temps dégrade,
surgit, inespéré, un liseré chahuté par une vague improbable.
Il vient déposer son offrande de lumière aux pieds du vagabond de l’âme.
Carmen P.