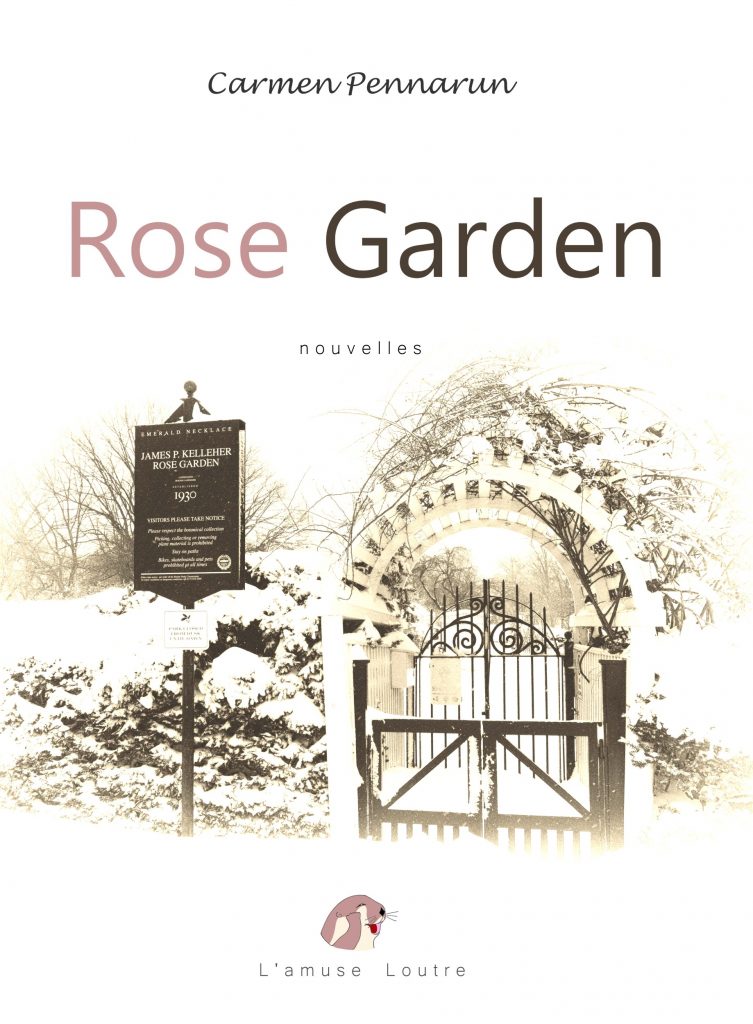Rose Garden
Un jardin enclos au cœur flou de la ville
–écrin baigné de roses où le soleil s’incline
–
Épris de caresses un ange décline
en vaguelettes ses plumes en élytres.
Le vitrail des couleurs pétale sa lumière
dans le bastion végétal où rien ne dérange
le calme solennel de l’instant naturel ;
un trouble se dépose au flanc de mes rêves.
…..………………………………………Carmen
Pennarun
Chapitre 1
Le rat de Boston
« Y aurait-il un Bon Dieu ? Même pour les rats ? » Cette question traversa un instant l’esprit de
Gérald, mais bien vite il se ressaisit, la tension qu’il devait maintenir pour maîtriser son chien ne permettait pas de telles divagations mentales.
« Ma foi, non, les rats n’ont pas besoin de Bon Dieu, ils se sortent de toutes les situations.
C’est ahurissant. Quel flegme ! Quelle intelligence ! »
Gérald pensait revenir tranquillement vers Down Town où il habitait en empruntant l’avenue du
Commonwealth. Il avait couru le long de Charles River et était satisfait de sa performance ; il avait
tenu un bon rythme et ce, malgré son chien qui parfois freinait des quatre coussinets et qu’il devait alors traîner sur plusieurs foulées. L’animal n’était peut-être pas un bon compagnon de
course, mais d’instinct il savait identifier une présence indésirable.
Le croisement de Commonwealth Avenue et d’Exeter Street faillit être fatal pour Gérald.
En même temps qu’il perçut le cri : « Oh, My God! », il entendit un bruit de freinage terrible et réalisa qu’une voiture arrivait sur
lui.
Mon Dieu se pouvait-il que ce soit sa fin ?!
Non, la voiture s’était arrêtée juste devant lui et le chien de Gérald tirait sur sa laisse en
aboyant. D’ailleurs son chien n’était pas seul à aboyer, d’autres aboiements et des cris de stupeur, de dégoût, se propageaient autour de
lui. Mais ce n’était pas lui qui était à l’épicentre de ce mouvement de panique, non, ce n’était pas vers lui que les regards convergeaient ; un peu
plus loin, sur la chaussée, un rat immobile les regardait.
Gérald retourna sur le trottoir où les piétons s’étaient tous arrêtés pour regarder le spectacle incongru d’un rat qui s’était matérialisé au milieu de la chaussée.
Durant quelques minutes la circulation était devenue un véritable capharnaüm. Le rat, figé,
attendait que la vie urbaine s’organise autour de sa personne ; chaque véhicule devait contourner l’obstacle, et les cyclistes l’éviter. Il attendit jusqu’à ce que tous reprennent leur rythme.
Les voitures, les vélos, leur trajectoire, droite. Les piétons, leurs déambulations bavardes, celui-ci avec son voisin, celui-là avec son i Phone.
Dès qu’un premier véhicule ignora sa présence, le rat se mit en mouvement, il partit d’abord en diagonale rapide, et s’arrêta – s’il avait
poursuivi dans cette direction et à la même allure, il aurait fini sous les roues d’une Dodge qui passait. Elle ne réussit pas à mordre dans sa vie car le rat s’arrêta, juste à temps, puis il bifurqua.
Il allait et venait sur la chaussée, sans jamais s’approcher du caniveau qui devait pourtant être son objectif. En marchant ainsi par avancées,
arrêts, retours, en lignes droites ou en diagonales, l’animal cherchait sa route dans un labyrinthe
mental connu de lui seul. Pour Gérald qui l’observait, ce n’était qu’une progression hasardeuse dont l’issue fatale était prévisible.
Si l’on avait dessiné le trajet du rongeur à la craie sur le bitume, une spirale sénestrogyre serait apparue, une spirale au tracé certes
tremblotant, mais qui se rapprochait à coup sûr de la bouche d’égout.
À aucun moment l’animal n’était passé sous une voiture. Comme pourvu d’un radar, il créait son parcours entre les véhicules en mouvement. Sa
démarche saccadée, faite d’arrêts brusques et de reprises spontanées, ressemblait à une danse bien orchestrée avec les monstres de la technologie montés sur roues, une danse dont la chorégraphie
tenait compte de l’obstacle juste avant qu’il surgisse. Le rat montrait à Gérald, qui l’observait, une
improvisation ingénieuse et impeccable face au danger.
C’est ainsi que le guerrier-rongeur sut maîtriser cette périlleuse situation, dans l’apparente indifférence générale. Le joggeur, lui, n’avait
rien perdu de la scène et son chien en grognait d’indignation.
Gérald fasciné par l’étonnante démonstration du rongeur restait figé sur place… Il dut bien
admettre que le proverbe : « Il y a un bon dieu pour les ivrognes ! » était en train de devenir une vérité absolue devant ses yeux. Sauf, qu’il ne savait pas si l’animal était groggy ou si cette
providentielle « immunité » contre les accidents avait pour cause la nature même de ce Buster !
Buster, le nom qui s’était imposé à son esprit alors qu’il observait le rongeur et qu’il pouvait
constater à quel point les animaux de cette espèce sont intelligents. Oh, il avait bien entendu parler de l’intelligence des rats, mais franchement, ce sujet était le cadet de ses soucis, jusqu’à
ce jour !
La circulation s’était maintenant stabilisée au carrefour de Commonwealth Avenue et d’Exeter Street. Gérald était le seul passant à ne pas avoir repris le rythme de sa propre marche. Son chien, que la scène n’amusait plus — il avait compris que
son maître ne lui permettrait pas de courser le rongeur — s’était couché, résigné, à ses pieds, en
attendant le bon vouloir de celui-ci. Il jetait de temps en temps vers lui un regard perplexe.
Le rat, contre toute attente, ne s’était pas faufilé dans la bouche d’égout. D’un bond, il s’était retrouvé sur le trottoir opposé, d’où
il regardait maintenant Gérald avec insistance et… sans la moindre hésitation, il fonça tout à coup dans sa direction à une vitesse déconcertante.
Gérald n’eut pas le temps de réagir. S’il resta de marbre, ce n’était pas, chez lui signe de self-control, son corps réagissait par une tétanie
émotionnelle à la peur causée par l’animal — appréhension doublée par la crainte de paraître ridicule aux yeux des passants s’il s’était laissé gagner par la panique.
Le rat le contourna par trois fois puis, passant entre ses jambes, il vint se planter juste en face de Gérald. Le rat regardait l’homme, comme
il le faisait avant, mais cette fois-ci ils étaient tous deux sur le même trottoir !
Gérald, debout, rigidifié dans un aplomb théâtral, et comme hypnotisé, ne tenait plus que par la
puissance du regard de l’animal.
Coup de foudre à Commonwealth Avenue ! Coup de
foudre par rat prémonitoire !
Gérald était dans une confusion extrême. Cet état il le devait sans doute, à une quelconque phobie héréditaire des rongeurs ou à une déficience
visuelle qui lui faisait prendre un écureuil pour un rat ! À moins que… Oui. Voilà l’explication : il était en plein rêve ! Il aurait
suffi d’une sensation physique – un pincement – pour sortir de ce cauchemar dont il ne voyait pas l’issue.
Sensation physique… passer en revue le corps… crispation à droite… d’une poigne de fer, sa main serrait la laisse du chien, au plus près de son
collier.
Sensation physique… trois impacts sur sa jambe gauche ; petits bonds du rat qui tentait de s’agripper à la jambe de son jogging.
« Putain de rongeur ! »
Là, malgré sa tétanie, Gérald réagit, il attrapa l’animal par la peau du cou — comme il l’aurait fait d’un chaton — et l’amena face à son visage
pour le foudroyer de son regard d’homme. Envolée la peur, yeux dans les yeux, à trois pouces de distance, l’homme et le rat se comprirent.
– OK, dit Gérald, allons à la maison ! Et il mit le rat, qui ne broncha pas, dans
son sac à dos.
C’est alors qu’une jeune femme, que Gérald n’avait pas remarquée auparavant, s’approcha de lui et souffla à son oreille.
« Thanks! » et elle lui glissa dans la main une carte de visite avant de traverser au
feu en courant.
Gérald ouvrit sa main et lut :
Kathleen Singer
Harvard Museum of Natural History
Department of Organismic and Evolutionary Biology
Boston, MA
Gérald glissa le bristol dans la poche de son jogging et s’empressa de rentrer chez lui. La présence du rat dans son dos lui fit monter les
étages quatre à quatre. Qui sait s’il n’allait pas lui prendre l’envie, à cet animal, de ronger son sac de sport, un Eastpak, super pratique mais pas
prévu pour le transport animalier !
Il trouva dans son cagibi, derrière les boîtes à chaussures, la cage de son défunt cochon d’Inde.
Il se félicita de ne pas l’avoir jetée et y déposa le rat sur un lit de journaux rapidement froissés.
« Ce n’est que provisoire, sieur Buster. Ne t’attends pas à plus de confort. Demain
j’aviserai, pour l’heure je décompresse et crois moi, c’est avec plaisir que je vais t’ignorer à partir de maintenant et pour le restant de la soirée ! »
Gérald gratifia son chien de quelques caresses, il
lui offrit sa ration de croquettes et comme pris de remords en balança quelques unes dans la cage de l’indésirable rongeur, puis il s’affala sur son
canapé. Devant lui, sur la table basse, un verre de bière et, à côté de lui, un sachet , bien mérité, de ses Dunkin’s Donuts préférés.
Il alluma la télé, la chaîne où les infos passent en continu, ce qui lui permettait de laisser errer ses pensées tout en ayant une chance de mémoriser l’ensemble de l’actualité. Les émotions de cette soirée ayant grandement affecté son aptitude au raisonnement, il se laissa
bientôt gagner par un doux engourdissement… la trêve fut de courte durée, il sortit de sa torpeur quand il crut reconnaître, en gros plan sur l’écran, un visage qui ne lui était pas inconnu. Et
pour cause c’était lui !
Les yeux écarquillés, il lut les sous-titres… Non, on ne parlait pas de lui aux infos. Aussi
incroyable que cela puisse paraître, cet homme était son sosie — Bradley Anderson, un éminent directeur de recherche, Le spécialiste des rongeurs au Musée d’Histoire Naturelle de Harvard.
Cette ressemblance, quelle coïncidence !
« Mais… Oh, My God, dit-il en se levant précipitamment, le bristol de la jeune femme ! Qu’en ai-je fait ? »
Il alla chercher dans la corbeille à linge la carte qu’il avait oubliée dans sa poche.
Cette K. Singer l’avait manifestement confondu avec M. Anderson ! Qu’attendait-elle de lui ? Quelle histoire ! My God quelle histoire !
Son chien que l’agitation de son maître inquiétait, sauta sur le canapé. Gérald, rassuré par cette présence dépourvue d’ambiguïté, finit par
s’endormir.
Le lendemain il se réveilla en catastrophe ; il n’avait pas de temps à perdre. Avant de se rendre à son poste de travail, à dix heures, il
avait l’intention d’éclaircir cette affaire de rat qui décidément prenait une drôle de tournure.
Avant de partir, Gérald enferma l’animal dans le cagibi. Il se méfiait des instincts de son compagnon canin et il avait comme le sentiment qu’il
lui fallait veiller sur la sécurité du rongeur, même si pour l’instant il en ignorait les raisons.
Il prendrait le bus pour aller à Cambridge. Il pesta car il ne retrouvait plus sa Charlie Card. Il chercha de la monnaie ; il lui faudrait payer cash le trajet.
Arrivé à Cambridge, il traversa le site de l’université de Harvard et eut bien du mal à se frayer un chemin devant l’imposante statue de John
Harvard qu’une délégation d’étudiants japonais mitraillait avec force exclamations. Gérald sourit ; que d’honneurs pour une statue qui de notoriété publique est le symbole d’une triple
imposture*… il leva les yeux vers le visage de bronze impassible du pasteur qu’il ne s’était
jamais donné la peine de regarder et, quelle ne fut pas sa surprise, d’y découvrir ses propres traits ! Statue des trois mensonges*,
ok, mais statue apte à provoquer la confusion dans un esprit jusqu’à ce jour sain, c’était une autre affaire ! Non, c’en était trop, dans quel
univers évoluait-il depuis sa rencontre avec le rat ?
Gérald se ressaisit, il avait une première énigme à résoudre. « Harvard, on règlera ce problème plus tard ! »
Il arriva au Musée d’Histoire naturelle et demanda à l’accueil un entretien avec K. Singer.
« Mais Monsieur Anderson vous pouvez aller dans son bureau ! » répondit la secrétaire.
Gérald allait s’empêtrer dans des explications quand il vit arriver la jeune femme.
« Ah, dit-elle, vous êtes l’inconnu à qui j’ai remis ma carte hier. Je vous avais tout d’abord pris pour M. Anderson ; vous lui
ressemblez tellement ! Même Z. one vous a confondus ! Mais en repensant, après coup, à votre attitude face à lui, j’ai compris ma
méprise.»
Kathleen était une femme à l’allure sportive. Sa démarche décidée, la souplesse qui accompagnait le moindre de ses mouvements renforçaient sa
féminité et Gérald était littéralement foudroyé par ses charmes. Tandis qu’elle lui expliquait le parcours de Z. one, lui, n’avait d’yeux que pour ce
chemisier de soie qui s’animait sous la respiration de la jeune femme. Gérald, emporté par ce souffle, voguait en pleine mer où il admirait à loisir des voiles à la couleur de ce chemisier, des
voiles gonflées par l’alizé de ses désirs. Dans le flot des paroles qui lui échappaient, il parvint tout de même à comprendre que Z .one et Buster,
son nouveau colocataire, n’étaient qu’un seul et même individu.
Il se ressaisit et releva son regard ; du corsage, il passa aux yeux de Miss Singer, là où il
lui était permis de plonger.
La jeune femme qui n’ignorait pas l’impression qu’elle suscitait généralement chez les hommes, lui fit remarquer.
– Vous semblez distrait, M. Hoar. Si je vous importune, dites-le moi ?
Gérald piqué dans son orgueil tenta de se justifier en évitant de sombrer dans le ridicule. Mieux valait jouer la carte de la sincérité.
– Veuillez m’excuser Miss Singer, j’étais parti dans des égarements esthétiques, mais je les préfère, je vous assure, à ceux déclenchés par ma
rencontre avec ce rongeur qui, d’après ce que j’ai compris, ignore les égouts de notre ville !
Ce compliment à mi-mots sembla embarrasser l’admirable sibylle. Elle en rougit mais sut rapidement se ressaisir. La femme, en elle,
éprouvait le besoin de prolonger la rencontre, la scientifique, quant à elle, souhaitait clarifier les pensées du jeune homme que les évènements
rocambolesques de ces dernières heures avait rendu confuses. Des explications s’imposaient.
– Venez, dit-elle, je vous offre un café, ce sera plus agréable pour discuter.
Face à face à la cafétéria, Gérald se montra particulièrement attentif à la scientifique, il n’avait pas besoin de se forcer pour la suivre, il
lisait sur ses lèvres, il buvait ses propos, il se savait incapable de résister à toute demande par cette bouche annoncée…
-« Z.one est un très vieux rat de laboratoire issu d’un clonage involontaire. Vous pourrez voir dans notre musée un spécimen de Rattus norvegicus qui n’est autre que notre Z.one naturalisé.
– Vraiment !
– Eh oui ! Les rats sont, pour nous scientifiques, des organismes modèles dont nous étudions la longévité. Nous répertorions les facteurs qui favorisent le rallongement de leur espérance de vie. Z. s’est révélé être un individu particulièrement intéressant, il
nous a étonnés par son intelligence qui dépassait largement celle des autres individus. Le groupe est très hiérarchisé, vous savez, et Z avait pris
un tel ascendant sur les autres rats, que ceux-ci en étaient arrivés à ne plus prendre aucune initiative. Ils se laissaient vivre, et ils vivaient bien. Ils abandonnaient à Z toutes les prises de risques ! La situation au labo devenait critique ; les rats se multipliaient et
le fait même d’avoir des descendants prolongeait la vie des vieux rongeurs qui continuaient de plus belle à procréer.
Vous souriez, mais nous avons dû euthanasier des rats en nombre ! C’est là que le stress s’est installé chez les rongeurs, à un point tel que le travail de plusieurs années allait être anéanti. Nous avons décidé de nous séparer de Z. en le remettant en liberté dans les rues de Boston,
une liberté surveillée. Nous savons la formidable capacité d’adaptation de ce rat, son ascendant sur ses congénères, avec lui nous allons prolonger nos expériences de labo sur le terrain.
J’ai un service à vous demander, dit-elle, avec un sourire à faire déborder la mer par-dessus les digues de ses dernières réserves,
pourriez-vous garder Z. quelque temps ? Il reviendra vers vous puisqu’il sait où vous habitez et qu’il ne fait pas de différence entre vous et M. Anderson. Nous vous demanderons juste de le
laisser sortir durant la nuit et de noter vos observations quotidiennement. Vous verrez combien il est facile de communiquer avec Z.
– Mais vous oubliez que j’ai un chien ! protesta-t-il mollement.
– Votre chien n’a rien à craindre de Z.
– Ce n’est pas ce que je voulais dire !
– Je sais ! Affaire conclue ?! dit Kathleen en se levant et en déroulant sa longue silhouette. »
Gérald se leva comme hypnotisé, il suivit la vague de la silhouette et à la sortie du fast casual, « Le bon pain » où la consommation d’un café avait suffi à le faire chavirer, il se surprit à promettre, tout en serrant la main de
Kathleen, de prendre bien soin de Buster-Z. one.
La jeune femme s’éloigna, elle traversa en courant Harvard square puis disparut…et Gérald se retrouva avec un rat sur les bras et cet espoir fou
de la revoir…
* Statue des trois
mensonges :
– Ce n’est pas J. Harvard qui a posé mais un étudiant, 250 ans après la mort du
pasteur.
– erreur sur la plaque : la date de la fondation est 1636 et non 1638.
– deuxième erreur sur la plaque : J. Harvard n’est pas le fondateur mais un donateur.