
J’ai perdu le fil




Mon âme est pareille à celle de l’arbre
bicentenaire. Son écorce craque
mais résiste aux révolutions, aux tempêtes
aux promesses éphémères. Chaque épreuve
est un trésor auquel, tout bien considéré,
j’accorde asile sur un de mes noeuds.
Le fragile appelle le plus grand des respects.
et ma vigilance de sève est à son écoute.
*

Il était sans doute venu sur cette presqu’île pour engranger dans sa mémoire quelques fleurs d’écume, pour éprouver des tonalités nouvelles, tout un nuancier de gris, auquel l’automne flamboyant de sa ville natale ne l’avait pas habitué.
Il y avait comme une résonance entre ces harmonies qui se refusaient à la clarté, et pourtant la rendaient si déchirante, et son âme juvénile enlisée dans la mélancolie.
La mer, le ciel et le vent s’alliaient pour créer ces volutes de neige de mer que l’on imaginait facilement nous transformer en bonhomme d’écume pour peu que l’on restât suffisamment longtemps immobile.
Ce qui le surprit ; cet air vif, ce déchaînement des éléments réveillait en lui une énergie qu’il croyait anéantie après ces années de mise au ban de la vie sociale, ces années où il avait dû taire la fantaisie de sa jeunesse, se plier à un règlement, avant de sortir avec pour seul bagage sa reconnaissance pour une personne qui s’était montrée attentive aux besoins qu’il ne ressentait même pas.
Il y avait donc encore en lui un feu intérieur, capable de raviver sa confiance atrophiée. Il sentait grandir au fur et à mesure de cette balade côtière un élan qui le forçait au redressement. Ce n’était pas simple impression, mais réalité mesurable. Les empreintes de ses semelles sur le sable glacé se distançaient ; sa foulée devenait plus ample. En même temps, sa vision au travers du voile de la brume devenait plus nette, comme si son regard haussait sa perception au-delà des obstacles. Le matériel n’était plus infranchissable, il pourrait rebondir. Il parviendrait à rassembler ses rémiges de moineau apeuré et à partir du poids plume de ses os, prématurément blanchis, il redéfinirait son ADN. Il deviendrait aigle, et son vol serait royal. La métamorphose était à l’œuvre.
Fini de rabâcher sa sempiternelle vieille histoire. Lui seul en réactivait le souvenir, la revivant encore et encore comme dans une nuit de cauchemar dont il est impossible de trouver une issue. L’aigreur des jours, à partir de cette tempête d’écume, il la remplacerait par l’alcalinité quotidienne.
.
Carmen P
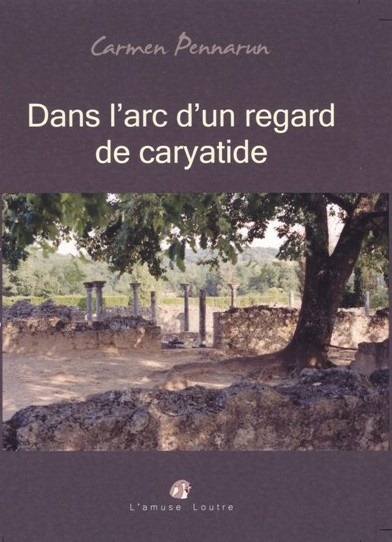
Dans l’arc d’un regard de caryatide, tel est le titre du recueil de poésie que je vous propose à la lecture.
Ces poèmes je les ai pensés comme un hommage à Francesca Woodman, jeune photographe américaine dont les clichés ne cessent d’interpeler un nombre toujours plus grand de personnes.
Elle est partie trop tôt, à vingt-deux ans, au royaume des anges, mais son oeuvre était là qu’il nous restait à découvrir. Ce fut pour moi un émerveillement poétique que d’entrer dans son univers.
Les photos d’un côté, ma plume de l’autre, ainsi s’est construit le dialogue entre la photographie et la poésie. J’ai tenté de restituer la dynamique de l’élan créatif qui a animé la jeune femme. Cet élan, tout artiste le porte en lui. En fait, il anime la vie de chacun de nous, même si nos créations sont modestes – elles ont leur importance car elles manifestent, à l’extérieur de nous nos visions intérieures.
Au moment de publier le livre il a fallu que j’abandonne les photographies de Francesca (pour une raison de droits). Comment publier un livre qui parle de photographies sans qu’y figure aucune photo. C’était impensable ! J’ai cherché parmi mes clichés et j’ai choisi des images qui n’ont certes rien à voir avec le côté mystérieux, parfois provocant, des photos de l’artiste (il n’était pas question que je me montre dévêtue), mais qui interrogent du regard, jouent avec le reflet d’ un miroir, ou montrent des architectures de l’ombre séculaire desquelles pourraient surgir des gardiennes de l’art.
Carmen Pennarun
Le livre compte 152 pages et 30 photographies en noir et blanc.
Son prix : 18 € (+ frais de port : 3€52)
[ me contacter par mail : carmen.pennarun@wanadoo.fr ]
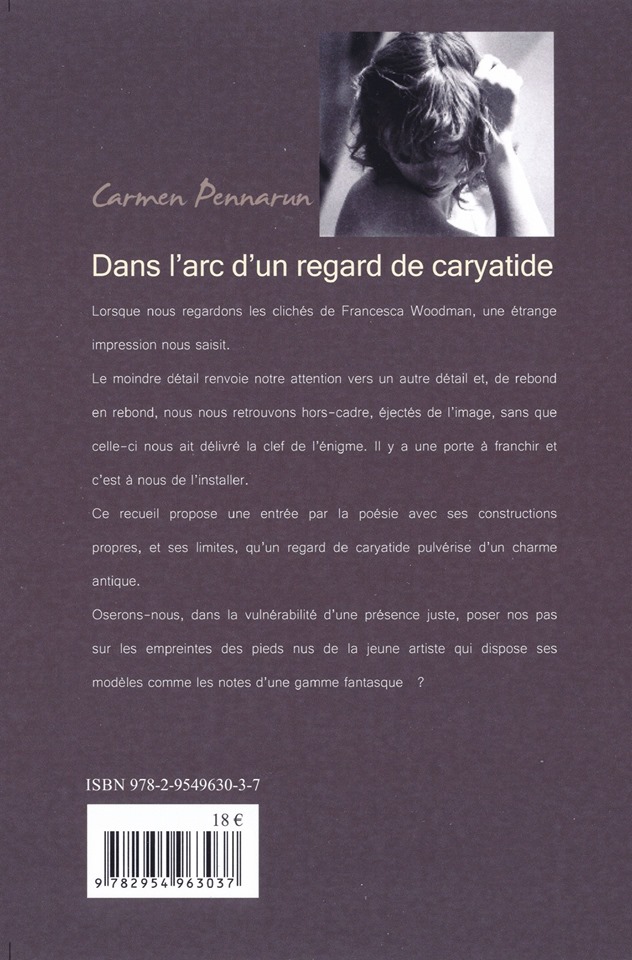
.

Quand les murs de vieilles pierres
baignés de lumière et de siècles
ressemblent à la tapisserie fleurie
vieux rose tremble mon coeur
caché sous le corail de la soie
et mes pensées carminent
que seul le futur chavire
Je le devine là
prélevant un soupçon
de présence et le confiant
au temps, ce grand amplificateur
derrière lequel tout s’efface
inexorablement
Carmen P.
.

L’inertie
était son ennemie
pourtant les objets
dans son mental s’animaient
d’un glissement imperceptible
d’une légère lévitation
Elle aurait pu manipuler le verbe
utiliser le rythme, s’ouvrir à la musique
elle a choisi le huitième art, la photographie
Elle ordonnait son énergie kinésique
sur des tableaux dont elle était le modèle
chaque construction était une tentative
de réunification, un réajustement de son corps
à la conscience morcelée. L’harmonisation était
le but du jeu – sa quête perpétuelle.
.
C.P.
photographie : Francesca Woodman

Femme caméléon,
elle essaie de soustraire son art aux lois de la physique.
Insoumise,
elle disparaît en elle-même quand elle ne s’éclipse pas du cliché d’un pas chassé.
Elle passe par ici. Elle repasse par là.
Jamais la même mais toujours présente, aucun regard ne parvient
à l’identifier vraiment.
Illusionniste,
elle crée des papillons qu’elle épingle aussitôt
comme autant d’âmes sororales qui s’échappent par des marges – inexistantes.
Cherchez-la, vous ne la trouverez pas !
Elle est toujours ailleurs car elle ne sait pas où vous fixer.
L’espace est une scène où les acteurs n’ont aucune marque.
De leurs textes ils ne brandissent que des graphies grignotées.
De leur présence on ne saisit que l’énigme.
La pensée, tel un tsunami, a balayé les planches avant qu’on ne soit installé.
La dispersion brouille toute lisibilité, mais c’est de ce trouble
que surgit l’évidence quand la patience s’en mêle.
La conscience au sein de chaque cellule, elle vit une existence cosmique
qu’elle tente de retracer en certains lieux délabrés
où le temps s’est abîmé.
Elle s’imagine entière mais elle se pulvérise à chaque tentative,
elle se dissémine en une multitude d’objets et demeure disloquée.
La profondeur du cliché naît de cet effet « poupées russes », où le message
ne se découvre qu’avec application, pour peu qu’on sache « déboîter » son regard.
.
Carmen P.
Photographie : Francesca Woodman

J’ignore les fantômes
mais je connais l’ange
qui derrière moi me pousse
*
Dites-moi
mots pétrifiés
ce goût de sel
si naturel
que fond de gorge
ressent dans ce vide
de bulles joyeuses
comme un aber
avide d’eau
ce goût de sel
ne se désagrégera-t-il pas
comme un iceberg
rompu par la chaleur
des émotions
trop humaines
*
Toi ma Terre
fais-toi discrète
je t’en supplie
En ce monde
où rien ne dure
on peut souffrir
longtemps seul
avant qu’une vague
d’espérance ne lève
notre dépendance
J’ai rejeté de mon âme
tout attachement
aux épreuves
je ne m’y balance
pas obstinément
Mon coeur, montre-toi
docile et mon visage
souris, confiant !
Vie, redresse-moi !
J’accepte que tu tiennes
mes ailes en laisse
Je ressens ce point d’attache
cette pression m’est douce
et libère mon souffle
À pleines branches, le vent !
.
C.P.
illustration : Francesca Woodman

Poing fermé / Main ouverte
Les mains, sur ce tableau de Dali sont remarquables. Souvent on ressent (de l’intérieur) tant de crispations dans nos mains, qu’elles soient ouvertes ou fermées !… à tel point que la position de relâchement paraît contre-nature – c’est dans cette position, pourtant, qu’elles se révèlent belles et apportent la détente autant au mental qu’au physique. Je me demande, si le fait de prendre conscience de cette relaxation ne permettrait pas, ensuite, de serrer les poings avant de passer à l’action plus efficacement ou d’ouvrir nos mains au monde plus généreusement.
***
C’est peut-être la mer
ou un cheval sans queue ni tête
un massacre en mouvement
***
sur le front de la dune
plus aucune mèche blonde
ne dévore le soleil ni ne court au vent
la vie a retiré toutes les promesses
qu’une marée d’amour avait dispersées
sur le sable en folie. Ne résonne plus – Entends !
la retombée des grains sur la conque du coeur
car toujours la mer s’obstine à embrasser la plage
et s’apprête à la blessure____que le temps remue
que le temps affine jusqu’à la brisure minuscule
***
si j’allais
sans me soucier de rien
pieds nus vers ce qui advient
donnant tout pouvoir à l’instant
les paupières en ailes de papillon
et le coeur à la pointe des orteils
si j’allais
suivant les caprices du temps
ou bien ceux de l’ennui
découper en mappemonde
la dentelle de mes jupons
***
Au fond de l’âme
l’esquisse d’une vague
interdite à déferler
sur la promesse de l’aube
Les baisers suspendus
au-dessus des reflets
de chair, le regard
derrière les paupières closes
tout concourt à la solitude
quand la planète stupéfaite
semble suspendre sa course
face à l’index de granite
qui ne lève pas mot
elle se réveillera
douloureuse
ardente
danse sa géologie cosmique
***

Ce n’est pas un dédoublement de personnalité, même si le phénomène peut paraître étrange à l’entendement ordinaire.
Tout se passe comme si il y avait quelqu’un en moi pour qui le prénom « Lucas » était familier.
Le simple fait de le prononcer revient à tirer sur un fil à bâtir et tous les souvenirs imaginaires
échappés d’un ouvrage dont la réalisation m’échappe viennent filer doux leurs soupirs.
Ce prénom, que je ne prononce jamais, vient mourir sur mes lèvres ; il esquisse, sur la langue du cœur, une présence faite de rêves non concrétisés.
Les rêves d’un ancêtre dont je ne serais pas l’unique héritière, mais envers qui j’aurais des devoirs en tant qu’exécuteur testamentaire.
Je dis « Lucas » et je pense peinture, une peinture comme une immense toile d’araignée dans laquelle je me prends les pieds, car la peur m’y enferre, alors que j’ai à l’esprit la conscience de pouvoir rebondir.
Ce prénom appelle une réponse. N’attend qu’un Oui. Lucas est un cri qui ne peut qu’être entendu.
Ce n’est pas le cri du nouveau né, celui qui annonce l’inspire et qui met en route le mécanisme de la vie,
c’est un cri plus mûr, plus rauque, un cri venu du profond du non-être. Un cri qui retourne notre propre terre,
à la recherche de ce qui ne peut plus souffrir l’enfouissement.
.
Carmen P.
illustration : Plinio Nomellini